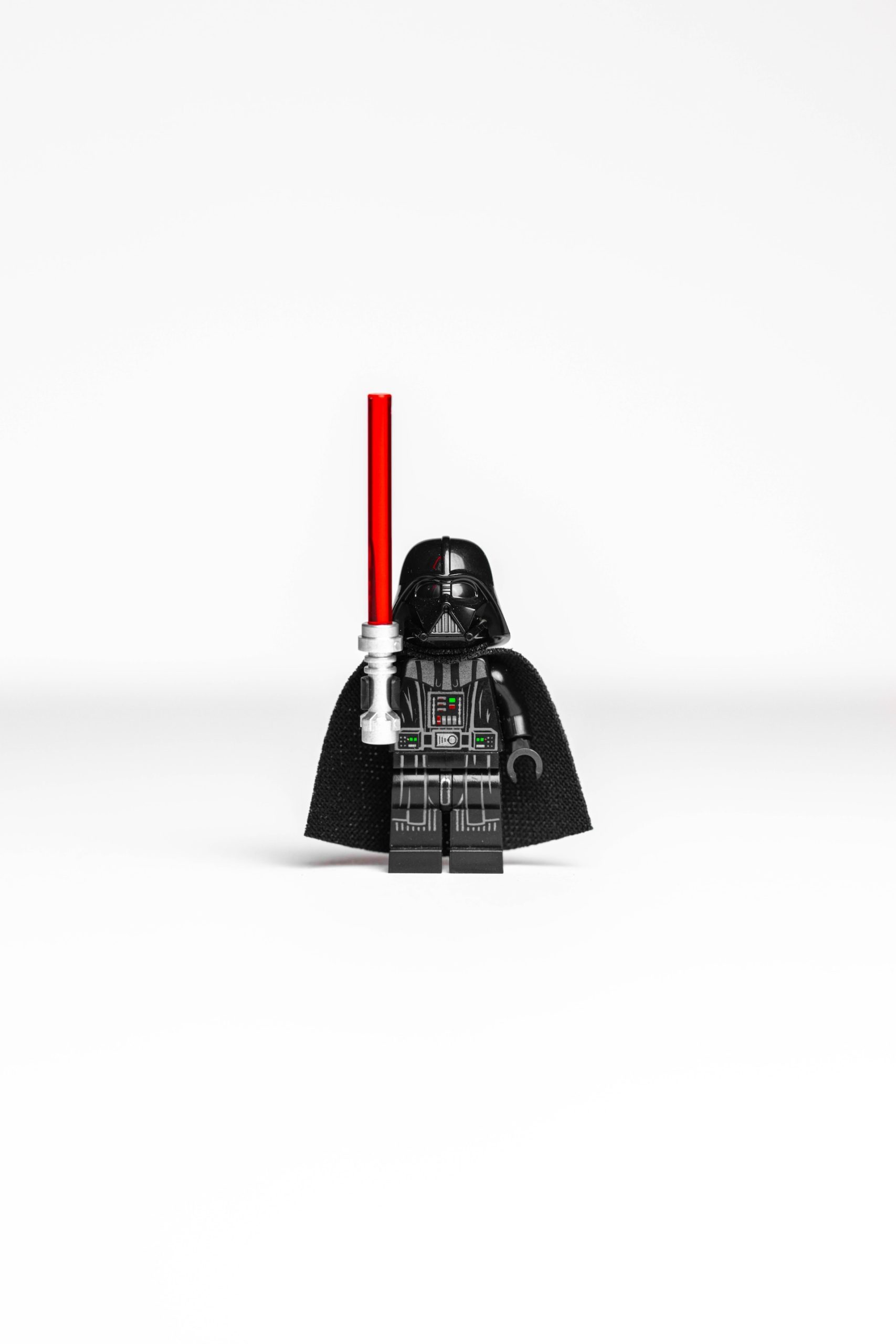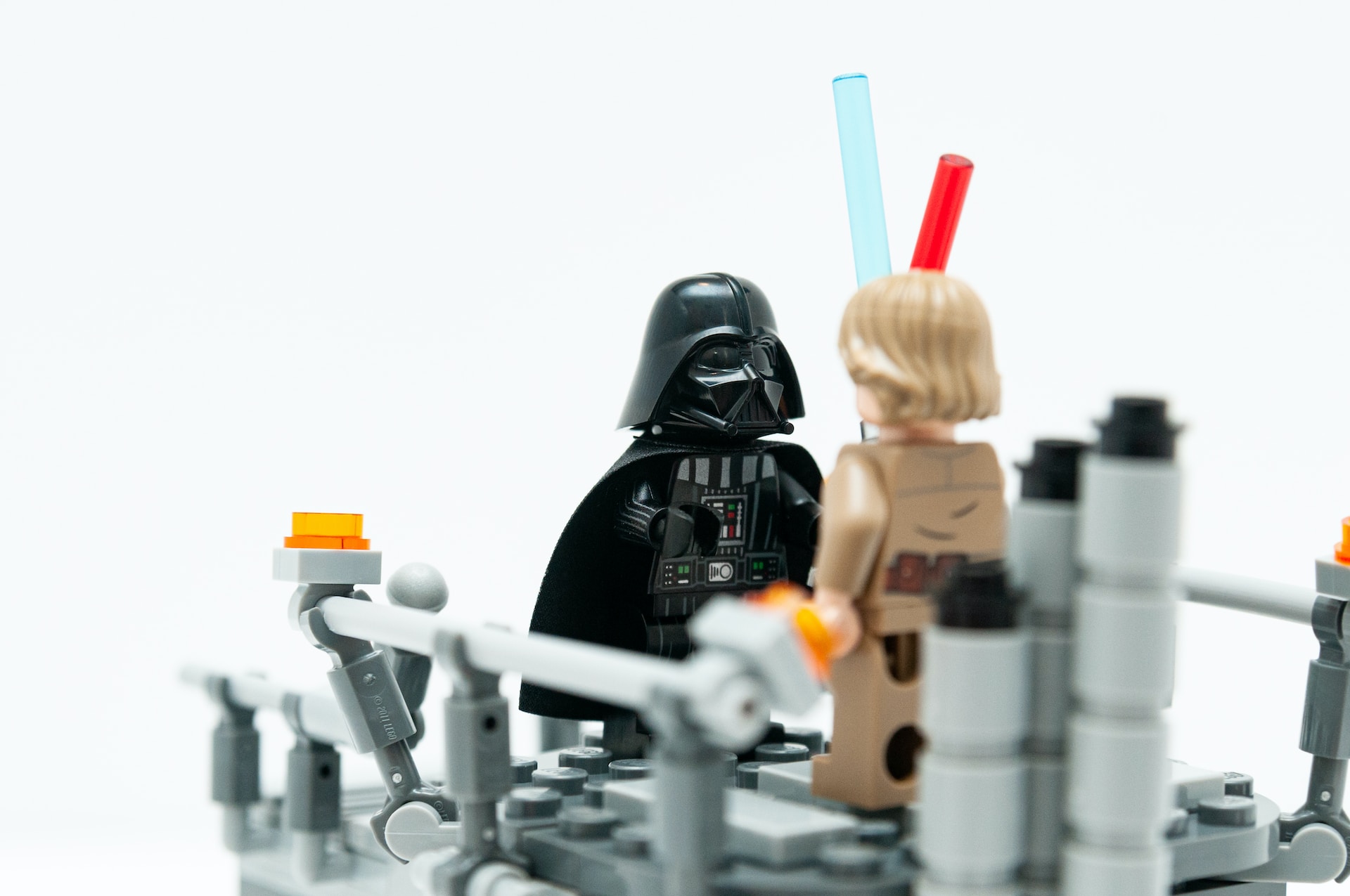La page blanche : comment surmonter une panne d’inspiration
Writer’s block : when your imaginary friends won’t talk to you.
Le syndrome de la page blanche : quand tes amis imaginaires ne veulent plus parler avec toi.
Haha, on a tous nos petites névroses quand on est auteur, n’est-ce pas ? Effectivement, mes personnages deviennent un peu mes amis imaginaires pendant l’écriture… Et ça peut être carrément angoissant quand ils arrêtent de te parler ! Tu te sens abandonné, stressé…
Mais que se passe-t-il ? Tu n’arrives plus à écrire… Peut-être depuis des heures, des semaines, voire des années… Pourquoi ?
Et comment sortir de cette « panne de l’écrivain », de ce « syndrome de la page blanche » ? Je t’explique tout dans cet article !
Cet article fait partie du Challenge « 52 articles sur l’écriture en 52 semaines : mon challenge foufou ! » : clique ici pour en savoir plus !
D’où vient ce blocage dans l’écriture ?
Déjà, sache que tu es loin d’être tout seul ! Des auteurs débutants aux plus aguerris, un bon nombre d’auteurs a déjà ressenti cette culpabilité de vouloir avancer sur son projet de roman, mais d’être coincé à ne rien pouvoir écrire… Ce syndrome psychologique a même un nom : la Leucosélophobie !
Tu es en manque d’idées, en manque d’inspiration, ta créativité est en berne, tu es en pleine remise en question… et donc en plein blocage… Mais d’où ça peut venir ?
Le syndrome de l’imposteur
Très souvent c’est le syndrome de l’imposteur qui se pointe, cette sensation que tu n’es pas à la hauteur, et que tout le monde va vite se rendre compte que tu es, en fait, incompétent. Tu doutes, tu perds confiance en toi : je n’ai pas vraiment de style, ça ne va intéresser personne, je ne vais jamais oser montrer mon travail aux autres… Tu penses que tu vas mal faire, mais en fait, tu te mets la pression, tu vises le perfectionnisme, et tout cela te fige !
Alors, quelles sont les solutions quand tu es face à un tel blocage ?
Les solutions face à un syndrome de la page blanche
Te dire que c’est normal !
Tout ne peut pas être parfait tout le temps. L’écriture d’un livre est cyclique, et si on n’expérimentait pas ces plus ou moins gros blocages de temps en temps, on apprécierait moins les moments où tout coule !
Et puis voir ce qui bloque permet de progresser. C’est normal d’avoir des doutes dans un processus créatif. C’est normal de ne pas être toujours au top de ses compétences, de faire des erreurs, de ne pas savoir. Ne soit pas trop extrême, ou irréaliste : tu ne peux pas tout savoir ! Accepte-toi tel que tu es.
J’ai déjà parlé de mon expérience avec les Oracles, ces petites cartes que j’utilise pour débloquer des scènes par exemple, dans mon article sur ma routine bien-être d’auteure.
La dernière fois, j’ai pu m’apercevoir clairement ce qui me bloquait : j’avais le contenu « intellectuel » de la scène, mais je ne savais pas ce que les personnages y faisaient, dans la matière ! Il a fallu creuser les personnages et la situation de départ, grâce à un tirage avec un Oracle, pour que mon imagination se débloque. J’avais enfin des idées, cohérentes par rapport aux scènes précédentes ! Trop chouette !
Alors cesse de te dévaloriser, apprends de tes échecs, et dis-toi que tu fais de ton mieux, que tu es capable, que tu es intelligent !
Avoir une structure narrative en amont
Dans mon article sur la structure narrative, j’ai écrit ceci : « Tu évites aussi grandement les blocages d’écriture. Écrire un roman peut être un processus difficile et les paralysies peuvent survenir à tout moment. Mais si tu as la feuille de route de ton histoire sous les yeux, tu peux plus facilement dépasser tout ça ! »
Je ne sais pas si c’est aussi simple que cela, mais je suis persuadée qu’avoir un plan, une structure à suivre pour ton histoire, ça peut grandement aider à contribuer à garder le cap, la motivation, et à ne pas se bloquer. En tout cas, je n’ai personnellement jamais eu de syndrome de blocage qui durait plus d’un jour ou deux…
En même temps, je suis d’accord aussi avec le fait que chacun est différent, et qu’on puisse se sentir bloqué par un plan défini. Donc c’est à toi de découvrir ce qui te convient, et ce qui t’aidera !
Revenir en arrière
Ce blocage peut être aussi tout simplement un problème dans ton intrigue, un personnage pas assez développé, un revirement improbable, un trou dans une scène ou dans l’histoire en général… Ma solution : relire quelques scènes, revenir en arrière pour trouver où ça bloque exactement… Et repartir du bon pied ! En relisant, en te replongeant dans ton intrigue, tu auras aussi relancé la dynamique, et je suis sûre que l’intérêt pour ce que tu as envie de raconter sera revenu, et l’inspiration avec !
Continuer à écrire
Surtout si tu n’en es qu’au 1er jet… Si tu t’arrêtes dès que tu doutes, dès que tu n’es pas sûr, et que tu n’as même pas couché ton histoire en entier sur le papier, alors le stress ne fera qu’augmenter face à la montagne de problèmes à résoudre ! Ne t’inquiète pas, tu as normalement pensé à ton lectorat en phase de préparation, et on aura ensuite la phase de réécriture pour arranger tout ça. Alors, lâche-prise !
Pour mon premier roman, j’ai fait le NANOWRIMO (on doit écrire tous les jours 1666 mots pour atteindre l’objectif de 50 000 mots au bout d’un mois). Du coup, je ne réfléchissais pas trop, je devais écrire, alors j’écrivais ! Ça me permettait de ne pas trop penser à mes futurs lecteurs, de ne pas me comparer, etc, tout ce qui peut faire peur, et d’être dans le pur plaisir de l’histoire.
Comme je le dis souvent, pense plutôt à comment tu seras fière d’avoir fini ce premier jet ! Et écris cette histoire pour toi, soit ton premier lecteur, et kiffe !
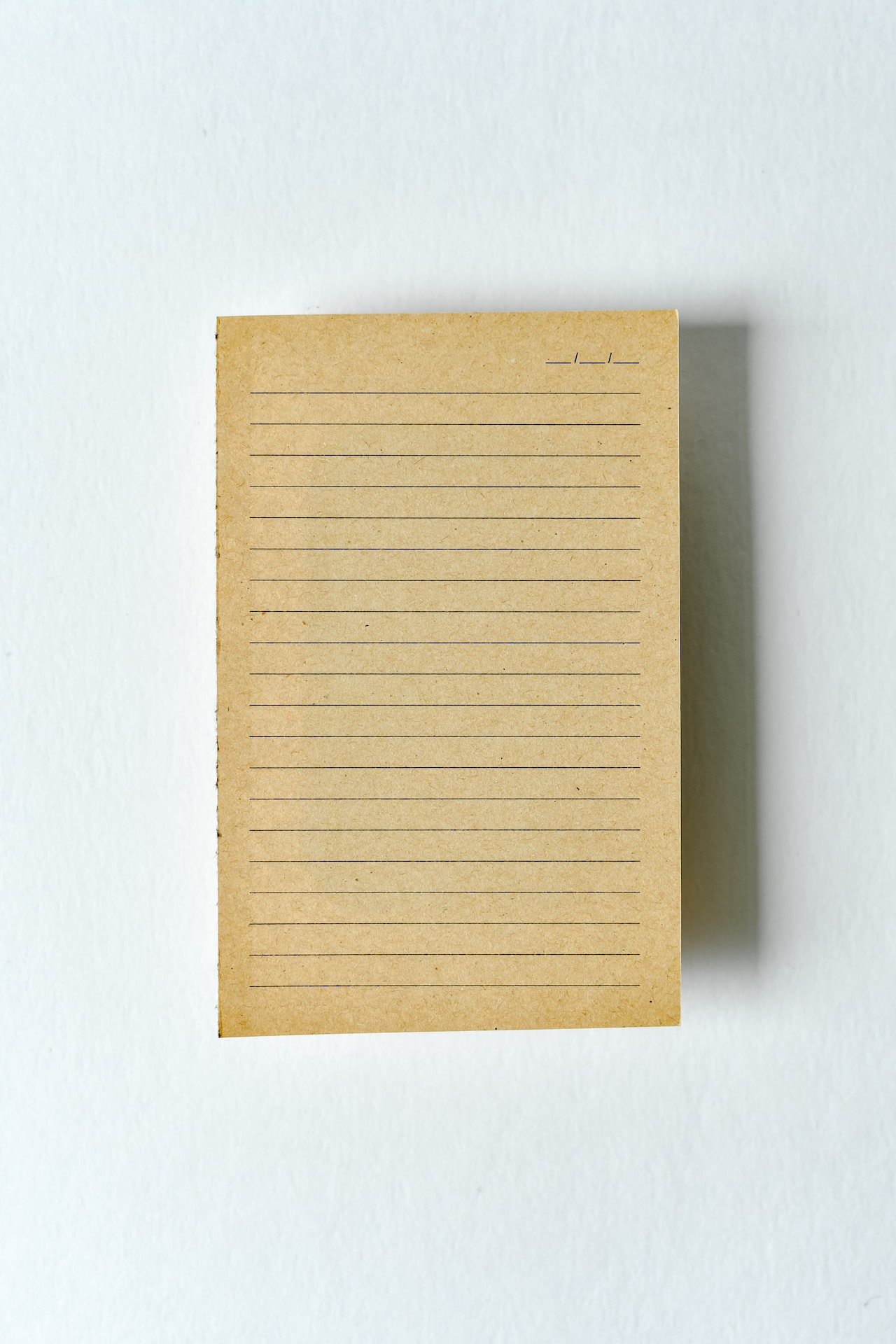
Ne pas combattre ton blocage
Et surtout, continue à écrire aussi en acceptant que tu as ce blocage. Tu ne dois pas le « combattre », mais tu ne dois pas l’écouter non plus…
Laisse ton blocage de côté, et l’inspiration et l’envie d’écriture finiront par revenir.
Crois en ta routine d’écriture
Tu as déterminé que tu étais dans la bonne dynamique pour écrire le lundi matin de 10h à 13h ? Alors écris pendant cette période ! Quel que soit ce que tu écris ! Passe à une autre scène, voire à une autre histoire, cherche des idées de prompts et écris une petite histoire sans t’arrêter pendant ces 3 heures, ou écris ton journal intime, les raisons de ton blocage… Tout ce qui peut te mettre le pied à l’étrier et te redonner envie d’écrire.
Ou alors, au contraire, dis-toi que tu ne vas écrire que 5 minutes. 5 minutes, ça ne paraît rien ! Mais c’est toujours 5 minutes de plus, et quelques pages griffonnées, un pas de plus vers ton projet fini ! Et je parie que tu auras envie de continuer au bout des 5 minutes…
Ou change de lieu d’écriture ! Où est-ce que tes personnages, ton histoire, auront envie de se reconnecter à toi ? Dans le métro ? En pleine campagne ?
Essaye de changer de moments pour écrire : le matin très tôt, ou dans la nuit…
Pour plus d’idées tu peux lire mon article « Trouve ton lieu d’écriture idéal et booste ta créativité et ton efficacité ! ».
Est-ce la bonne histoire pour toi en ce moment ?
Et si le blocage ne passe pas ? Interroge-toi : ce n’est peut-être ce n’est pas la bonne histoire pour toi, en ce moment, finalement… Et tu sais quoi ? Tu as le droit de la laisser tomber ou de la mettre de côté ! Qui est là pour t’obliger à écrire un truc qui ne te plaît plus ? Personne ! Alors surtout pas toi !
Mais continue quand même à écrire : choisis un autre projet et lance-toi ! Peut-être un projet plus court, comme une nouvelle ?
Rappelle-toi pourquoi tu écris ce livre là
Dans mon article « Écrire un livre : comment oser libérer l’auteur qui sommeille en toi », je te donne la méthode pas à pas pour déterminer pourquoi tu écris ce livre-là et pas un autre, en ce moment.
Alors trouve ton pourquoi si ce n’est pas déjà fait. Si cette raison est assez forte, ça devrait te rebooster et tu seras capable de continuer. Tu as envie de poursuivre ce rêve d’écrire un roman, ou pas ?
Ose !
Dis-toi que tu as de l’ambition (écrire un livre, tout de même ! Ce n’est pas à la portée de tout le monde), que tu as l’envie de faire quelque chose de plus grand que toi (et que tu as déjà commencé !).
Retrouve ce qui t’anime dans l’écriture, pourquoi c’est une passion pour toi ? Retourne à tes valeurs, pourquoi l’écriture t’apporte-t-elle tant ? Est-ce que ça t’aide à te sentir mieux ? À t’accomplir ? À contribuer au monde ? À devenir celle ou celui que tu es vraiment ? À inspirer les autres ? À divertir les autres ? Donne-toi la permission d’être qui tu es vraiment !
Ne continue pas à écrire !
Oui, je sais, je me contredis ! Mais je pense qu’il vaut mieux te donner toutes les solutions, parce qu’il y aura plus de chances pour que celle qui te convient là, tout de suite, maintenant, te saute aux yeux et, j’espère, t’aide à surmonter et à vaincre ce blocage d’écriture.
Donc, je te conseille aussi d’arrêter d’écrire, de reposer ton cerveau, pour sortir du cercle vicieux. Fais une pause, prends le temps de prendre du recul, fais quelque chose qui te procure du plaisir.
Et je parie qu’à un moment donné, tu sentiras que la machine a envie de se remettre en route, quand elle se sera suffisamment ressourcée.
Fais autre chose
La majorité du temps, quand j’ai une panne d’écriture, ce qui marche chez moi pour tout débloquer, c’est quand je me change les idées. J’aime bien dans ces cas-là « remplir mon puits à imagination » comme disent les anglais (« to fill the well« ) en lisant ou en regardant des films ou des séries. Ça peut vraiment débloquer les choses !
Alors laisse tout ceci reposer et maturer, va aérer ton esprit, t’inspirer en t’amusant, pour peut-être créer de nouvelles scènes ou images dans ta tête, que tu auras envie de mettre par écrit, ou tout simplement pour cesser de tourner tout ceci en boucle dans ta tête…
Quoi faire ?
- Regarde des images sur Pinterest, des vidéos sur Youtube, en rapport ou non avec ton histoire (moi je regarde des scènes de rencontre, de fin, etc, pour me mettre dans l’ambiance)
- Lis un livre (fiction ou non fiction)
- Regarde un film, une série
- Écoute des podcasts
- Écoute de la musique
- Fais une activité physique
- Fais une autre activité créative : dessin, cuisine, tricot, danse, chant, graphisme…
- Va te balader dehors, profite de la nature
- Pose des questions à Chat GPT pour qu’il te donne des idées
- Pars en week-end, en vacances, découvre de nouveaux lieux, de nouvelles habitudes de vie, de nouvelles personnes
Ne te compare pas
Dans ces moments de blocage et de doutes, arrête de passer son temps sur les comptes des autres auteurs ! Quand on voit que telle auteur, avec un nouveau bébé, publie 3 livres alors qu’on est toujours sur notre 2ème depuis 2 ans… ça peut être très démoralisant (oui, c’est un exemple véridique !).
Mais chacun est différent, chacun a un temps disponible différent, une avancée dans l’écriture différente, une exigence différente aussi.
Je sais maintenant que j’ai besoin de prendre du temps pour mes romans, qu’ils ont besoin de mûrir, et qu’en plus je les veux de la meilleure qualité possible parce que je suis comme ça et que mes lecteurs méritent ça ! Donc je ne culpabilise (presque) plus à prendre du temps à les écrire.
Trouve quelqu’un avec qui parler de ton histoire
Un autre auteur, un collectif d’auteurs, un bêta-lecteur, quelqu’un de ton entourage en qui tu as confiance, à qui tu vas raconter ton histoire, ou ton blocage… Papoter peut aider à débloquer beaucoup de choses !
Pas forcément parce que les gens en face vont te trouver LA solution, mais juste parce que ça aide de déposer ses problèmes devant nous, de les exprimer à d’autres, plutôt que de les laisser tourner en rond dans notre cerveau, sans fin
Un moodboard pour ton roman
C’est un conseil dont j’ai déjà parlé sur ce blog, dans « Trouve ton lieu d’écriture idéal et booste ta créativité et ton efficacité ! » : mets sous tes yeux des images ou des mots qui sont liés à l’histoire que tu es en train d’écrire, et qui te parlent et donc t’inspirent (les lieux, les personnages, les émotions…), mais aussi les couvertures de tes romans passés, ou tout ce qui se rapporte à ta passion de l’écriture, ou ta capacité à écrire (les prix que tu as gagnés, ta première dissertation…).
Une solution extrême
Il existe des logiciels ou des appli qui, si tu arrêtes d’écrire, autodétruisent tes premiers mots ! À la base, leur but est d’aider les auteurs à se concentrer et à atteindre leurs objectifs d’écriture, en utilisant les conséquences négatives comme motivation… ou punition…
Je trouve ça carrément effrayant (voire chronophage, quand il s’agit de retrouver ces mots effacés !) et un peu trop violent à mon goût (le stress que ça doit engendrer !) mais si c’est ce qui te convient, fonce !
Write or die par exemple a plusieurs modes, de « Gentil » avec des récompenses positives à « Kamikaze » avec la suppression de texte…
C'est parti mon kiki : passe à l'action !
1. Dis-toi d’abord que tu n’es pas seul à vivre ça, et que c’est même normal
2. Relis tous les conseils de cet article, puis choisi une action que tu vas mettre en place tout de suite (abandonner ton roman, écrire tout autre chose, aller te balader, faire un marathon : tu as le choix et plein d’idées dans cet article !)
3. Et si tout va bien, regarde les résultats arriver et les mots couler de nouveau sur ta feuille !
Partage tes astuces ! Quelles méthodes as-tu utilisées pour surmonter la page blanche ? Laisse un commentaire ci-dessous et aide d’autres auteurs !